
Système
urinaire
les Reins
2 infatigables filtres
les Reins
2 infatigables filtres
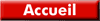 |
 |
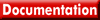 |
 |
 |
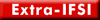 |
 |
Deux
infatigables filtres
De
l'urine, notre corps en
rejette, chaque jour, un litre et
demi. Mais pour la produire, ce
sont quelque 180 litres de sang
que nos reins ont dû filtrer.
Un
liquide jaune pâle, un peu acide, qui dégage vite une légère
odeur d'ammoniac. Un mélange de divers produits chimiques et déchets
indésirables, d'eau, de sels minéraux...
Chaque jour, il en sort
des reins 1,5 litre en moyenne. C'est assez peu, certes. Mais la production
de ce volume d'urine demande aux reins un travail de titan.
Pour l'obtenir,
il leur aura fallu filtrer quelque 180 litres de sang, sans compter les globules.
Ce qui revient à épurer en boucle, plus de 60 fois de suite,
tout le sang du corps. Un grand nettoyage sanguin, une fois toutes les demi-heures...
Dans un premier temps, le rein ne fait pas dans le détail. Il prend
tout ce qui lui tombe sous la main, ou presque.
Le système de filtre
est assez simple :
----- d'un
côté, le sang, qui entre dans les reins
et y chemine dans de fins capillaires, à haute pression.
-----
de l'autre,
un ensemble de tubes microscopiques, prêts à recueillir la
future urine.
Et
entre les deux, une très fine barrière,
qui laisse très facilement passer l'eau. Poreuse, mais pas trop,
elle barre la route aux globules sanguins et aux grosses molécules,
comme l'albumine.
Pour traverser sans écueil et se retrouver côté urine,
une seule condition : mesurer moins de 3 millionièmes de millimètres.
Globules, plaquettes et grosses protéines n'ont aucune chance.
Passent à travers
le tamis, dans le désordre, les sucres, les acides aminés
et tous les sels minéraux, accompagnés d'une foule d'autres
produits chimiques.
Et côté sang, le contenu des capillaires
se retrouve hautement concentré : un bon cinquième de son
volume passe de l'autre côté de la barrière. Noyé dans
un premier jus très dilué, qui a encore peu à voir
avec de l'urine.


3
millionièmes
de millimètre
pourront passer.
Pas
question de laisser fuir tout ce liquide dans la nature. Car l'organisme se
viderait par la vessie, en moins d'une heure...
Maintenant qu'il a tout filtré,
le rein doit faire marche arrière et récupérer les éléments
vitaux. Et il y met les moyens. Plus question d'utiliser un simple système
de filtre. Il faut dépenser de l'énergie.
Les tubes microscopiques,
dans lesquels s'écoule l'urine en formation, disposent de toute la machinerie
nécessaire.
Dans la paroi, les cellules portent des protéines
spéciales, qui fonctionnent comme de minuscules pompes.
Chacune est
spécialisée dans la récupération d'un élément
: l'une, le glucose, l'autre, une vitamine...
Molécule par molécule,
les pompes capturent les composés et les réinjectent dans leur
milieu d'origine, le sang.
L'énergie nécessaire, elles la trouvent
en consommant le principal carburant de la cellule, l'ATP.
Le procédé est
d'une efficacité redoutable : un rein en bon état de marche ne
laisse pas s'échapper une miette de glucose ou d'acide aminé dans
les urines. Mieux, il fait d'une pierre deux coups. Car en même temps,
les pompes aspirent des ions sodium, pour les renvoyer dans le sang. Qui récupère
ainsi une grande partie de son sel.
Les lois de la physique font le reste, ou du moins beaucoup.
Lorsque les sels
retournent dans le sang, l'eau tend, par nature, à les suivre. Une question
d'équilibre : l'eau a tendance à circuler des zones les plus
diluées vers les zones les moins diluées.
Comme
elle diffuse sans problème à travers les tissus, elle quitte
les tubules et rejoint les vaisseaux sanguins.
Par ce simple jeu de poursuite,
plus des trois
quarts de l'eau soutirée du sang y retournent sans tarder.
Et l'organisme
est sauvé de la déshydratation.
Le mécanisme marche aussi à l'envers. En retournant dans le
sang, l'eau entraîne, avec elle, des petites molécules. Car
elles aussi se déplacent par diffusion, vers les zones les plus diluées.
Certains
sels minéraux et des petits composés chimiques suivent
ainsi l'eau de façon passive. Et rejoignent, eux aussi, le sang.
Le
plus gros est fait : l'essentiel des éléments vitaux,
sucres, vitamines, eau et sels minéraux, est retourné dans
l'organisme.
D'autres mécanismes d'ajustement, réglés
cette fois par des hormones, se chargeront de récupérer encore
un peu d'eau ou de sels. Selon les besoins.
Que reste-t-il alors dans l'urine?
Toutes les
substances indésirables, issues de la filtration du sang, comme
l'urée
ou l'ammoniac. Ou l'urochrome, ce pigment qui vient de la destruction de
l'hémoglobine
et qui donne au liquide sa belle couleur jaune.
Certains déchets
y sont parvenus par d'autres moyens. Trop gros, ou en raison de leur charge électrique,
ils n'ont pas pu être filtrés hors du sang.
C'est le cas,
par exemple, de médicaments comme la pénicilline ou les barbituriques.
Pour
les éliminer, le rein a eu recours à un ultime mécanisme.
Il les a sécrétés directement dans l'urine en formation, à travers
la paroi des tubes microscopiques. La technique lui a aussi permis d'augmenter
la quantité d'urée et d'ammoniac relarguée.
Quand au sang, il sort du rein, filtré, débarrassé de
ses déchets, puis recomposé. Jusqu'au prochain tour.